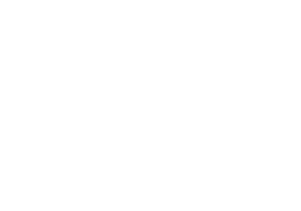
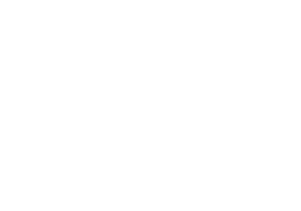
Une profonde réorganisation judiciaire est en cours de déploiement. Dès le 1er janvier 2020, les tribunaux d’instance et de grande instance fusionnent pour donner naissance à des tribunaux judiciaires aux
Dans ces matières, l’accompagnement par un avocat est une condition essentielle de l’effectivité du recours au juge.
Le principe de la représentation obligatoire des parties ne peut, en principe, qu’assurer une meilleure présentation des causes et favoriser la qualité des décisions juridictionnelles, dans un contexte de complexification du droit.
Ainsi, avocats et magistrats pourront ensemble élaborer l’œuvre de justice à laquelle ils aspirent.
Suivre les notions de base et les recommandations de ce guide, c’est aussi éviter les risques de responsabilité professionnelle.
I - La présentation générale des conclusions.
La forme des conclusions a été modifiée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 d’application de la loi pour la réforme de la justice publié au Journal officiel du 12 décembre 2019, qui vient modifier de nombreuses dispositions du Code de l’organisation judiciaire.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Il est applicable aux instances en cours à cette date.
La structuration des écritures est désormais régie par le nouvel article 768 du Code de Procédure Civile.
Pour respecter le nouvel article 768 du Code de Procédure d’appel et ainsi éviter que la non-conformité des conclusions des parties n’engendre le rejet des débats, on conseille de privilégier une écriture soignée et synthétique de l’argumentation.
L’avocat doit garder en tête que l’objectivité et la concision de l’exposé des faits, doublées de la clarté et de la précision de l’exposé des moyens de droit, seront un travail utile pour le magistrat qui aura à rédiger la décision et donc au-delà pour obtenir satisfaction.
D’un point de vue pratique, on doit y voir un parallélisme évident entre le jugement rendu et les écritures signifiées tant sur l’exposé du litige, que la motivation, le dispositif :
1- Le rappel très synthétique des faits et de la procédure.
2- La discussion avec l’énoncé numéroté des prétentions et de leur fondement en fait et en droit, chaque prétention devant faire référence aux pièces sur lesquelles elle se fonde, en les numérotant dans les motifs des conclusions au fur et à mesure de leur utilisation de façon à permettre au juge de cerner immédiatement l’objet de l’instance.
3 - Le dispositif appelé le « Par ces motifs » des conclusions doit reprendre exclusivement les prétentions des parties dans l’ordre des motifs.
L’article 768 du Code de procédure civile définit ce que doit être le contenu des conclusions soumises au Tribunal et différencie d’une part les prétentions et, d’autre part, les moyens de fait et de droit.
Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
Le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.
A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats.
En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées, à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 765 n’auront pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication.
La remise au greffe de la copie de l’acte de constitution et des conclusions est faite soit dés leur notification avec la justification de leur notification, soit celle-ci est antérieure à la saisine de la juridiction, avec la remise de la copie de l’assignation.
II - L’exposé des faits et de la procédure.
L’exposé des faits doit être objectif, concis, documenté par des pièces.
Le rappel des faits et de la procédure doit présenter de manière narrative les éléments de fait.
Ce n’est donc ni le moment d’entamer le débat, ni de formuler des demandes.
Un bon exposé des faits permettra des renvois au stade de la discussion pour éviter des redites qu’il faut absolument combattre.
L’avocat doit aussi garder en tête que l’objectivité et la concision de l’exposé des faits, doublées de clarté et de la précision de l’exposé des moyens de droit dans la discussion, seront un travail utile pour le magistrat qui aura à rédiger la décision et donc au-delà pour obtenir satisfaction.
Il faut impérativement bannir en tout état de cause les exposés trop longs qui n’en finissent pas, même si le client tient à y raconter absolument tout.
Le travail de l’avocat est pédagogique à l’égard du client.
Le travail de l’avocat est de faire en quelque sorte "le pont entre le juge et le justiciable".
D’un point de vue pratique, il ne sert donc à rien de mentionner tous les éléments du contexte.
Il faut en faire une synthèse qui doit se concentrer sur les seuls faits opérants du litige.
Dans un souci de lisibilité, le rappel des faits doit donc impérativement proscrire les formules telles que : "les allégations de la partie adverse", les signes d’exclamation etc.
III - Dans la discussion doivent être présentée chaque prétention s’appuyant sur ou plusieurs moyens à l’appui des pièces ou de précédents jurisprudentiels.
La discussion doit présenter les prétentions et chaque prétention s’appuyer sur un ou plusieurs moyens principaux ou subsidiaires, à l’appui des pièces ou de précédents jurisprudentiels.
La "prétention" est l’affirmation en justice tendant à réclamer quelque chose soit de la part du demandeur, soit de la part du défendeur et dont l’ensemble détermine l’objet du litige [1].
La prétention pour le défendeur vise aussi bien les moyens de défense procéduraux (exceptions de procédure et fins de non-recevoir) que les défenses au fond.
Conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile qui différencient les prétentions des moyens (tout en réservant le dispositif des écritures aux prétentions), on entend par prétention le résultat recherché strictement entendu ou de façon plus souple le résultat recherché qualifié juridiquement lequel ne doit pas s’accompagner du moyen de droit ou de fait qui le soutient.
Le principe de structuration des écritures doit être considéré comme un moyen permettant de s’assurer de la concentration des moyens : le juge doit pouvoir trouver facilement énoncés les moyens de fait et de droit dont il trouvera la conséquence énoncée dans le dispositif des écritures.
Au stade la discussion, il est indispensable à l’avocat de respecter l’ordre de présentation des exceptions de procédure, des fins de non-recevoir et des moyens relevant de la défense au fond.
Dans la mesure où il ressort de la jurisprudence que le juge n’a pas l’obligation de requalifier les faits ou de modifier le fondement juridique de la prétention, sauf à rouvrir les débats on invitera l’avocat à être particulièrement précis, là encore, dans le choix des moyens qu’il aura à opérer.
Les fondements doivent être très clairs.
Dés lors que les conclusions sont un peu abondantes, il est important de résumer (soit au début de l’exposé d’un moyen par un chapeau, soit à la fin de l’exposé d’un moyen un peu long) le moyen soulevé.
Il peut être aussi intéressant de numéroter les moyens pour faciliter au juge sa lecture et lui éviter d’en oublier, en fin de lecture.
Enfin, s’agissant des conclusions "récapitulatives", rappelons qu’un effort de synthèse est nécessaire, des conclusions "récapitulatives" n’étant pas des conclusions "cumulatives" comme elles le sont trop souvent.
Une bonne connaissance de l’article 768 du Code de Procédure Civile, en l’état des calendriers de procédure extrêmement longs (la clôture est rarement envisagée à moins d’un an après l’assignation du demandeur) devrait aussi permettre aux avocats de distinguer leurs conclusions "intermédiaires" (qui peuvent ne porter que sur un point de la procédure ou de la discussion) des "dernières écritures" par lesquelles ils prendront quelque temps avant la clôture leurs "prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions "antérieures.
D’un point de vue pratique, le principe de loyauté qui est l’un des piliers de la déontologie des avocats doit inciter à marquer d’un trait en marge des ajouts ou modifications de ses écritures pour en faciliter la lecture à son contradicteur et au juge.
IV - Les références jurisprudentielles doivent être limitées.
Les références jurisprudentielles doivent être limitées à de courtes citations avec renvoi en bas de page des références des jurisprudences publiées et production aux débats des jurisprudences inédites
Il faut impérativement bannir en tout état de cause les citations trop logue de la jurisprudence que le magistrat peut consulter.
V - Le dispositif doit recevoir un traitement tout particulier.
L’article 4 du Code de Procédure Civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Il n’est pas un résumé des tous les moyens qui ont été exposés, mais le simple énoncé des prétentions.
Le juge doit être à même de trancher sur ce qui est demandé dans le dispositif.
Le juge doit répondre à chaque prétention.
Le juge doit-il se prononcer sur les "dire et juger " contenu au dispositif ?
Les diverses demandes de "dire et juger que "(…) ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
En application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les ‘dire et juger’ et les ‘constater’ ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
S’agit-il de soumettre également aux dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, les conclusions adressées au juge de la mise en état ?
On peut répondre aussi à cette question par l’affirmative.
Les "donner acte, constater" et autres formules de ce type doivent être prohibées.
A titre d’exemple en matière civile « dire et juger qu’un contrat est nul » n’est pas une demande de nullité.
Il doit donc être demandé au juge de prononcer la nullité du contrat.
Enfin et surabondamment, on rappellera à l’avocat quelques moyens simples d’alléger les écritures comme l’usage parfois parcimonieux des adverbes, la construction de phrases simples et courtes (un sujet, un verbe, un complément), le caractère superflu de certaines mise en cause ironiques de la partie adverse généralement suivie d’un ou plusieurs points d’exclamation, la totale inutilité de demander la condamnation à une amende civile dont l’initiative n’appartient qu’à la juridiction, l’importance à vérifier si l’exécution provisoire est possible ou parfois si elle n’est pas tout simplement de droit, de demander la restitution de sommes auxquelles une partie a pu être condamnée en première instance alors que l’infirmation de la décision par la Cour d’appel aura cet effet automatique.
Là encore, il s’agit d’alléger des écritures inutilement alourdies par de telles considérations.
Références :
Décret n° 2019-914 du 30 août 2019, JO 1er sept. Création du tribunal judiciaire : les conséquences pratiques
Décret n° 2019-913 du 30 août 2019, JO 1er sept. : Nouveau tribunal judiciaires : les mesures de coordination
Décret n° 2019-965 du 18 septembre 2019 : Substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d’instance
Décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 : Substitution du tribunal judiciaire relative à l’organisation judiciaire modifiant l’annexe du décret n° 2019-913 du 30 août 2019