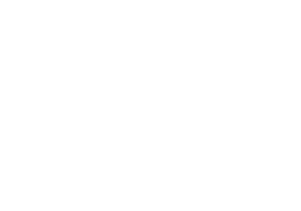
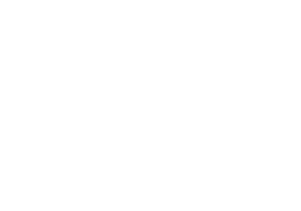
L’arrêt de l’exécution de provisoire résulte de l’adoption du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 des décisions rendues par le Juge de l’Exécution au visa de l’article R121-22 alinéa 3 du Code procédure Civile.
Par dérogation au droit commun, ce texte n’a pas été modifié par la réforme.
Il n’est donc pas exigé la démonstration des moyens sérieux d’annulation et de conséquences manifestement excessives.
Il convient d’alerter les plaideurs ce qui les conduira à adapter leur stratégie procédurale.
1- La réforme de la Procédure Civile qui résulte du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 consacre le principe de l’exécution provisoire.
Elle soumet, en cas d’appel l’arrêt de l’exécution provisoire par le Premier Président à une condition nouvelle : l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation qui s’ajoute à la nécessité de prouver que l’exécution de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
2- Toutefois, le sursis à exécution des décisions rendues par le Juge de l’exécution dont la compétence appartient au Premier Président régi par l’article R121-22 alinéa 3 du Code de Procédure Civile diffère profondément du droit commun.
3- Cette nature particulière apparaît dans l’étude de son domaine et des moyens à faire valoir à l’appui d’une demande de sursis. Elle conduira les plaideurs à adapter leur stratégie procédurale.
1) Le domaine du sursis à exécution.
4- Principe - L’article R121-22 alinéa 3 du Code de Procédure Civile ainsi libellé prévoit que :
« le sursis à exécution des décisions rendues par le Juge de l’Exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la Cour ».
Remarque :
Il est à noter que ce domaine est radicalement différent de celui de la suspension de l’exécution provisoire de droit commun de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
5- Seules les mesures prises par le Juge de l’Exécution et non celles qui refuse d’ordonner peuvent faire l’objet d’une demande de sursis.
Certains ont pensé qu’il était possible de saisir le Premier Président dans tous les cas que soit la décision rendue par le Juge de l’exécution avec l’avantage que l’assignation en référé suspendrait le cours de l’exécution.
C’est ainsi, qu’ont été déposées des demandes de sursis dans le cas d’ordonnances du Juge de l’exécution refusant de surseoir à l’exécution, déboutant le débiteur d’une demande de nullité d’une saisie-attribution ou d’une saisie-vente, rejetant une demande en revendication d’objets saisis.
Seules les mesures prises par le Juge de l’Exécution et non celles qui refuse d’ordonner peuvent faire l’objet d’une demande de sursis. Si le Juge de l’Exécution n’ordonne aucune mesure, le référé Premier Président est donc sans objet et doit être rejeté.
Attention !
Citons un certain nombre de mesures qui peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution : la mainlevée de saisie-conservatoire, la mainlevée de saisie-attribution, le cantonnement de saisie-attribution, le cantonnement d’une hypothèque judiciaire, la caducité d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, la rétractation d’une ordonnance autorisant à pratiquer une saisie conservatoire, la condamnation personnelle du tiers saisi, la restitution d’une somme, l’annulation d’une procédure d’expulsion, l’annulation d’un cantonnement...
2) Les moyens à faire valoir à l’appui d’une demande de sursis à exécution.
6- Principe.
En cas d’appel d’une décision rendue par le Juge de l’Exécution, un sursis à exécution peut toujours être demandé au Premier Président de la Cour d’appel en démontrant simplement qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la Cour. A cet égard, il faut rappeler que la loi ne distingue pas selon que ces moyens touchent au fond du litige ou à la procédure.
7- Contrôle du sérieux des moyens.
Le Premier Président dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation. Il doit se prononcer sur le sérieux ou au contraire de l’absence de sérieux des moyens invoqués. Sa marge d’appréciation est importante.
8- Il semble aujourd’hui difficile de prédire l’intensité du contrôle qui sera exercé par le Premier Président.
En effet, la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire des dispositions applicables en matière d’exécution forcée n’est pas venue préciser la notion de « moyen sérieux ».
Il n’est pas certain que l’on puisse en tirer des enseignements utiles en entreprenant l’exégèse des décisions retenant des moyens « susceptibles d’entraîner l’infirmation du jugement », « suffisamment sérieux » ou « pas dépourvus de sérieux » [1].
9- Il n’est pas exigé la démonstration de conséquences manifestement excessives - Certains ont pensé se fonder sur le droit commun des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire pour voir accorder le sursis à exécution. Mais, la jurisprudence décide que le sursis à exécution était étranger à l’article 524 du Code de Procédure Civile.
Attention !
Le pouvoir conféré au Premier Président par l’article R121-22 alinéa 3 du Code de Procédure Civile constitue une exception légale faisant échec par dérogation au droit commun édicté par l’article 514 du Code de Procédure Civile.
10- Il s’agit d’un texte spécifique, autonome qui est étranger au droit commun et les arguments relatifs aux conditions d’application de l’article 514 du Code de Procédure Civile n’ont pas lieu d’être examinés puisque la demande n’est pas fondée sur les dispositions de ce texte. On peut donc résumer que les conséquences manifestement excessives alléguées ne sont pas applicables.
Attention :
Cependant, cet examen n’exclut pas celui des conséquences manifestement excessives de l’exécution, mais celles-ci ne constituent pas la cause limitative d’admission de la demande comme cela résulte de l’application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
11- Que faut-il en déduire ?
Dans le cadre d’une demande de sursis à exécution, il y a lieu de soutenir que les moyens d’appel qui apparaissent sérieux par quelques indications sommaires et appropriées.
Remarque : on peut relever ici l’analogie qui existe entre le sursis à exécution et l’article R661-1 du Code de Commerce en matière de procédure collective qui permet au Premier Président de surseoir à l’exécution des jugements de liquidation judiciaire « si les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux ». Le sérieux des moyens est à rapprocher également de « la contestation sérieuse » de l’article 808 ancien du Code Civil en matière de référé de droit commun et aussi de « l’obligation non sérieusement contestable », clé du référé provision de l’article 809 alinéa 2 ancien du Code Civil.
12- Est-ce pour autant qu’il ne peut être fait état des conséquences manifestement excessives de l’exécution ?
Conseil pratique :
A notre avis, celles-ci peuvent être invoquées à condition de ne pas viser l’article 514 du Code de Procédure Civile inapplicable en la matière et comme simple argument à l’appui de la demande de sursis, puisque l’article R121-22 du Code de Procédure Civile n’apporte aucune limitation quant aux moyens qui peuvent être invoqués. Le Premier Président saisi sur le fondement de l’article R121-22 du Code de Procédure Civile n’a pas à respecter les strictes limites fixées et conserve toute liberté d’appréciation pouvant notamment rechercher s’il existe des motifs sérieux de réformation.
Références :
ORF n°0288 du 12 décembre 2019
Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile
(Voir du même auteur le guide pratique détaillé de cette réforme.)